Trois actrices qui n’ont plus rien à prouver sinon leur incroyable facilité à enchaîner les rôles les plus divers. Mlle Streep serre un caniche pour les besoins de «She-devil», comédie trépidante dont elle est la vedette. Ses rivales, elles, préfèrent conjuguer leur image à tous les temps du mode glamour. Finies, lessivées, out, les années BO. Rassurez-vous, nous n’allons pas, une fois de plus (et de trop?) regretter ces années grises bel et bien mortes et enterrées. Le train vient de s’arrêter à la gare Mille-neuf-cent-quatre-vingt-dix, tout le monde descend et, variation plus amusante, on descend tout le monde. Le jeu des bilans pour rire se mue en jeu de massacre et les rescapés ne sont pas toujours ceux et celles que l’on croit. Prenons les actrices américaines qui, du haut de leur «staritude» dominent allègrement la précédente décennie, celle des années 70 : Barbra Stressante, Jane Fondue et Faye Thunes Away. D’immenses professionnelles selon le cliché consacré, de sacrées emmerdeuses selon leurs ex. Et talentueuses avec ça. Très. La légende d’Hollywood les dépeint volontiers comme de redoutables mères fouettardes, fôlles d’elles-mêmes et pour qui chaque rôle prend les allures d’un effeuillage de marguerite du style «je m’aime beaucoup, passionnément, à la folie». A force de mouiller son royal tarin à toutes les sauces, Barbra finit par perdre son flair et se commet dans des superproductions aussi stériles qu’inutiles. Jane, elle, croit avoir trouvé l’arme absolue anti-décrépitude : l’aérobic, gaillardement filmé, enseigné, martelé en body pur lycra. Manque de chance, son ingrat de mari va tellement bien voir ailleurs si elle y est, qu’il y resté. Avec, de surcroît, une nymphette de vingt ans la cadette de dame Jane. Quant à Faye, elle se mue à corps et visage défendant en offre d’emploi permanente pour le remake de «La femme au masque de cire». Mais, comme dit l’autre, l’histoire (surtout celle du cinéma) est un perpétuel recommencement. Et les prétendantes au trône se bousculent au portillon pour apporter leur gracieuse contribution à ce qui ressemble fort à un nouvel épisode de «Poussez pas mémés dans les orties». Sally Field pleurniche en technicolor et à tout va, GoldieHawn frôle la dilatation d’orbite à force d’écarquiller les yeux, Sissy Spacek.et Diane Keaton rivalisent d’efforts dans le genre «je suis la fille cachée de M. Spok mais je me soigne». Leurs efforts méritoires sont récompensés par une pincée d’Oscars, mais d’éternité cinématographique, point. Heureusement qu’entre-temps naît une trinité autrement plus fascinante, la «Streep-Lange-Turner unlimited». Aucun superbe rôle ne lui échappe et les tâches sont réparties afin que chacune y trouve son compte. A Meryl Streep, dite Oscarella, tous les personnages à accent (condition quasi obligatoire) et à la destinée si possible tragique. Elle est tour à tour Tchèque résignée dans «Voyage au bout de l’enfer», Oxfordienne torturée dans «La maîtresse du lieutenant français». Polonaise rescapée des camps nazis ET torturée dans «Le choix de Sophie», Danoise installée au Kenya dans «Out of Africa», pocharde désespérée dans «Ironweed», Australienne au look mongolien et accusée d’infanticide dans «Un cri dans la nuit». Sans oublier le projet avorté de «Evita » où elle manqua d’incarner l’Argentine Eva Peron. A Kathleen Turner, tous les emplois de garce-enquiquineuse à qui on ne la fait pas. Aventurière intrigante dans «La fièvre au corps», elle prend du galon et passe au rang de beautiful peste malfaisante dans «L’homme aux deux cerveaux». Plus tard, elle cumule avec une très évidente jubilation les fonctions de vicieuse-folle de son corps («Les jours et les nuits de China Blue») et de tueuse à gages ludique («L’honneur des Prizzi»). Histoire d’arrondir les angles et avec la complicité de Michael Douglas, elle réactualise la notion de couple hollywoodien. Douglas lorgne du côté bougon-Spencer Tracy, Turner louche vers les insupportables-façon Katharine Hepburn et les tiroirs-caisses se remplissent aussitôt, («A la poursuite du diamant vert», «Le diamant du Nil»). Pour sapart, Jessica Lange affiche une très nette préférence vers des personnages volontiers plus complexes et difficiles d’accès. D’où, dans un premier temps, de mémorables compositions : Cora dans le chaud remake du «Facteur sonne toujours deux fois» et, surtout, «Frances», héroïne douloureuse et fille spirituelle disjonctée d’Adèle Hugo et de Camille Claudel. Les choses se gâtent ensuite. Les beaux rôles se succèdent, mais le public se fait tirer l’oreille. «Sweetdreams», «Country», «Crimes du cœur», «Far north» ou encore «Everybody’s all american», autant de titres qui traversent brièvement le box-office sans réussir à s’imposer. Sans obstruer la trajectoire de Jessica, ces relatifs échecs réduisent quelque peu sa marge de manœuvre. En effet, la règle numéro un à Hollywood veut que, par définition, les plus alléchantes propositions aillent d’abord aux acteurs avec de récents succès commerciaux à leur actif. A ces derniers, ensuite, de trancher entre les offres intéressantes artistiquement et celles qui renfloueraient: leur compte en banque. Là réside toute la différence entre un Nicholson et un Stallone. La marge est encore plus réduite pour les femmes qui, à cause d’une misogynie largement répandue dans la profession, trouvent rarement de beaux personnages une fois franchi le cap de la quarantaine. D’où une boulimie de rôles valorisants et puissants entre vingt-cinq et quarante ans, histoire de mieux préparer la suite. Quand, au cours de cette période, les choses ne se déroulent pas comme prévu, une très discrète révision s’impose_ Exemple : Jessica Lange qui, échaudée par ses précédents échecs, se montre des plus pointilleuses quant au choix de ses nouveaux rôles. Extrêmement déçue par le montage final de «Everybody’s ail american» (inédit en France), elle hésite longuement avant d’accepter la proposition de Costa-Gavras qui lui soumet, fin 1988, le scénario de «The music box». Après de nombreuses modifications du script et des heures de discussion avec le réalisateur et le scénariste. Lange finit par donner son accord de principe. Elle se glisse pendant trois mois dans la – peau d’Ann Talbot, brillante avocate de Chicago d’origine hongroise et dont le père est accusé d’avoir été, dans sa jeunesse, un tortionnaire nazi. «Je ne pense pas avoir interprété de personnage aussi différent de moi qu’Ann, précise l’actrice. Voilà une femme vulnérable sentimentalement, mais qui évolue dans un univers masculin et s’en sort admirablement. Elle a une certaine dureté, une froideur qui ne résistent pas aux secousses émotives qu’elle éprouve par la suite. « The music box » est vraiment un film qui m’a touchée pendant le tournage, et surtout après, quand j’ai vu la version finale, c’est une sensation que je n’éprouve pas souvent, tant on peut avoir de mauvaises surprises au montage». Malicieux signe du destin ou simple coïncidence, Jessica s’essaie, dans Ce film, à l’accent « Europe de l’Est», très léger mais tout de même perceptible, spécialité que l’on croyait réservée à la Streep. Meryl, vous avez dit Meryl? Parlons-en, justement. Malgré sa position de vedette féminine N° 1 aux États-Unis, ses derniers films («Un cri dans la nuit», «lronweed») ont beaucoup mieux marché à l’étranger que sur le territoire américain. Sans se renier le moins du monde, l’actrice s’implique alors dans des entreprises moins étouffantes et plus accessibles que les précédentes, mais tout aussi intéressantes. « Postcardsfrom the edge», où elle vient d’être dirigée par Mike Nichols, est l’adaptation du récit autobiographique de l’actrice Carne Fisher, best-seller immédiat lors de sa parution. «She-devil», sur les écrans à partir du 21 mars, est librement inspiré de «The life and loves of a she-devil», classique de la littérature anglo-saxonne contemporaine. Face à Roseanne Barr (superstar de la télé américaine et héroïne d’un feuilleton portant son nom). Meryl réussit le prodige de traverser un film entier lookée blonde-glamour, sans accent particulier et, plus surprenant encore, en suscitant les rires plutôt que les larmes. «Depuis dix ans, je dis un peu partout que je veux jouer une vraie comédie mais, jusqu’à « She-devil », je n’avais rien trouvé de très excitant, raconte l’intéressée. J’interprète ici une romancière qui entretient les rêves d’adolescente avec lesquels elle a grandi. Elle est fascinée par le mythe de la difficulté d’être une femme. Elle perpétue cela dans ses livres et le pratique jusqu’à l’excès dans sa vie privée. Personnellement, je suis très intéressée par les images auxquelles la femme est supposée ressembler en général. C’est là une des principales raisons qui m’ont poussée à tourner le film de Susan Seidelman», Cette déclaration historique à peine effectuée, et voilà notre tragi-comédienne vaquant à son occupation favorite, la chasse aux bons rôles. De son côté, l’incandescente Kathleen Turner s’aventure — cinématographiquement — sur le même terrain, celui de la comédie grinçante à souhait. Dans «La guerre des Rose», elle est entourée par Danny de Vito (également réalisateur du film) et Michael Douglas. Énième application de la formule «on prend les mêmes et on recommence»? Pas vraiment. Loin des cavalcades effrénées de ses précédentes tribulations, le trio est au centre d’une fable aussi cruelle que mordante tournant autour d’un couple. Barbara et Oliver Rose, empêtré dans une procédure de divorce qui n’en finit plus. L’agitation d’ «A la poursuite du diamant vert» et du «Diamant du Nil» cède la place à un humour méchant, ravageur, qui sied superbement à Kathleen : «Ce film est très différent des deux autres que j’ai tournés auparavant avec Michael et Danny, avoue-t-elle. Ce dernier n’était plus un simple comparse, mais le patron. Quant à Michael, n’assumant plus les responsabilités de producteur, il a pu se consacrer entièrement à son jeu. Le résultat auquel il est parvenu est mille fois plus intéressant et excitant que tout ce que nous avons pu faire ensemble auparavant». Définissant son personnage, elle ajoute : «Barbara a une forme de liberté que j’envie. Elle n’hésite pas à transgresser les règles du savoir-vivre et de la bienséance. Elle se moque totalement de ce que peuvent penser les autres. La peur du qu’en-dira-t-on ne l’empêche jamais d’agir. Elle sait exactement ce qu’elle veut et ce .qui est juste et injuste. Elle ne doute pas un seul instant. Certes, cela peut aller jusqu’à manque de considération pour autrui, et même jusqu’à un côté terriblement destructeur. Mais l’aspect positif, c’est sa volonté farouche et sa faculté d’agir sans arrière-pensée…» Cette détermination est on ne peut mieux accueillie par le public américain qui catapulte «La guerre des Rose» à la première place du box-office pendant près de trois mois. Une bonne nouvelle de plus pour Kathleen Turner dont les derniers films («Julia et Julia», «Scoop») n’ont pas réalisé les résultats escomptés. Remises en selle, Jessica, Meryl et Kathleen peuvent aujourd’hui dormir tranquilles et aborder sereinement le virage des années 90. Dans les coulisses, de tendres biches et des louves affamées attendent leur tour. Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah et les autres sauront être patientes. Elles connaissent les règles du jeu. Et ce jeu-là vaut tellement la chandelle…
Leurs efforts méritoires sont récompensés par une pincée d’Oscars, mais d’éternité cinématographique, point. Heureusement qu’entre-temps naît une trinité autrement plus fascinante, la «Streep-Lange-Turner unlimited». Aucun superbe rôle ne lui échappe et les tâches sont réparties afin que chacune y trouve son compte. A Meryl Streep, dite Oscarella, tous les personnages à accent (condition quasi obligatoire) et à la destinée si possible tragique. Elle est tour à tour Tchèque résignée dans «Voyage au bout de l’enfer», Oxfordienne torturée dans «La maîtresse du lieutenant français». Polonaise rescapée des camps nazis ET torturée dans «Le choix de Sophie», Danoise installée au Kenya dans «Out of Africa», pocharde désespérée dans «Ironweed», Australienne au look mongolien et accusée d’infanticide dans «Un cri dans la nuit». Sans oublier le projet avorté de «Evita » où elle manqua d’incarner l’Argentine Eva Peron. A Kathleen Turner, tous les emplois de garce-enquiquineuse à qui on ne la fait pas. Aventurière intrigante dans «La fièvre au corps», elle prend du galon et passe au rang de beautiful peste malfaisante dans «L’homme aux deux cerveaux». Plus tard, elle cumule avec une très évidente jubilation les fonctions de vicieuse-folle de son corps («Les jours et les nuits de China Blue») et de tueuse à gages ludique («L’honneur des Prizzi»). Histoire d’arrondir les angles et avec la complicité de Michael Douglas, elle réactualise la notion de couple hollywoodien. Douglas lorgne du côté bougon-Spencer Tracy, Turner louche vers les insupportables-façon Katharine Hepburn et les tiroirs-caisses se remplissent aussitôt, («A la poursuite du diamant vert», «Le diamant du Nil»). Pour sapart, Jessica Lange affiche une très nette préférence vers des personnages volontiers plus complexes et difficiles d’accès. D’où, dans un premier temps, de mémorables compositions : Cora dans le chaud remake du «Facteur sonne toujours deux fois» et, surtout, «Frances», héroïne douloureuse et fille spirituelle disjonctée d’Adèle Hugo et de Camille Claudel. Les choses se gâtent ensuite. Les beaux rôles se succèdent, mais le public se fait tirer l’oreille. «Sweetdreams», «Country», «Crimes du cœur», «Far north» ou encore «Everybody’s all american», autant de titres qui traversent brièvement le box-office sans réussir à s’imposer. Sans obstruer la trajectoire de Jessica, ces relatifs échecs réduisent quelque peu sa marge de manœuvre. En effet, la règle numéro un à Hollywood veut que, par définition, les plus alléchantes propositions aillent d’abord aux acteurs avec de récents succès commerciaux à leur actif. A ces derniers, ensuite, de trancher entre les offres intéressantes artistiquement et celles qui renfloueraient: leur compte en banque. Là réside toute la différence entre un Nicholson et un Stallone. La marge est encore plus réduite pour les femmes qui, à cause d’une misogynie largement répandue dans la profession, trouvent rarement de beaux personnages une fois franchi le cap de la quarantaine. D’où une boulimie de rôles valorisants et puissants entre vingt-cinq et quarante ans, histoire de mieux préparer la suite. Quand, au cours de cette période, les choses ne se déroulent pas comme prévu, une très discrète révision s’impose_ Exemple : Jessica Lange qui, échaudée par ses précédents échecs, se montre des plus pointilleuses quant au choix de ses nouveaux rôles. Extrêmement déçue par le montage final de «Everybody’s ail american» (inédit en France), elle hésite longuement avant d’accepter la proposition de Costa-Gavras qui lui soumet, fin 1988, le scénario de «The music box». Après de nombreuses modifications du script et des heures de discussion avec le réalisateur et le scénariste. Lange finit par donner son accord de principe. Elle se glisse pendant trois mois dans la – peau d’Ann Talbot, brillante avocate de Chicago d’origine hongroise et dont le père est accusé d’avoir été, dans sa jeunesse, un tortionnaire nazi. «Je ne pense pas avoir interprété de personnage aussi différent de moi qu’Ann, précise l’actrice. Voilà une femme vulnérable sentimentalement, mais qui évolue dans un univers masculin et s’en sort admirablement. Elle a une certaine dureté, une froideur qui ne résistent pas aux secousses émotives qu’elle éprouve par la suite. « The music box » est vraiment un film qui m’a touchée pendant le tournage, et surtout après, quand j’ai vu la version finale, c’est une sensation que je n’éprouve pas souvent, tant on peut avoir de mauvaises surprises au montage». Malicieux signe du destin ou simple coïncidence, Jessica s’essaie, dans Ce film, à l’accent « Europe de l’Est», très léger mais tout de même perceptible, spécialité que l’on croyait réservée à la Streep. Meryl, vous avez dit Meryl? Parlons-en, justement. Malgré sa position de vedette féminine N° 1 aux États-Unis, ses derniers films («Un cri dans la nuit», «lronweed») ont beaucoup mieux marché à l’étranger que sur le territoire américain. Sans se renier le moins du monde, l’actrice s’implique alors dans des entreprises moins étouffantes et plus accessibles que les précédentes, mais tout aussi intéressantes. « Postcardsfrom the edge», où elle vient d’être dirigée par Mike Nichols, est l’adaptation du récit autobiographique de l’actrice Carne Fisher, best-seller immédiat lors de sa parution. «She-devil», sur les écrans à partir du 21 mars, est librement inspiré de «The life and loves of a she-devil», classique de la littérature anglo-saxonne contemporaine. Face à Roseanne Barr (superstar de la télé américaine et héroïne d’un feuilleton portant son nom). Meryl réussit le prodige de traverser un film entier lookée blonde-glamour, sans accent particulier et, plus surprenant encore, en suscitant les rires plutôt que les larmes. «Depuis dix ans, je dis un peu partout que je veux jouer une vraie comédie mais, jusqu’à « She-devil », je n’avais rien trouvé de très excitant, raconte l’intéressée. J’interprète ici une romancière qui entretient les rêves d’adolescente avec lesquels elle a grandi. Elle est fascinée par le mythe de la difficulté d’être une femme. Elle perpétue cela dans ses livres et le pratique jusqu’à l’excès dans sa vie privée. Personnellement, je suis très intéressée par les images auxquelles la femme est supposée ressembler en général. C’est là une des principales raisons qui m’ont poussée à tourner le film de Susan Seidelman», Cette déclaration historique à peine effectuée, et voilà notre tragi-comédienne vaquant à son occupation favorite, la chasse aux bons rôles. De son côté, l’incandescente Kathleen Turner s’aventure — cinématographiquement — sur le même terrain, celui de la comédie grinçante à souhait. Dans «La guerre des Rose», elle est entourée par Danny de Vito (également réalisateur du film) et Michael Douglas. Énième application de la formule «on prend les mêmes et on recommence»? Pas vraiment. Loin des cavalcades effrénées de ses précédentes tribulations, le trio est au centre d’une fable aussi cruelle que mordante tournant autour d’un couple. Barbara et Oliver Rose, empêtré dans une procédure de divorce qui n’en finit plus. L’agitation d’ «A la poursuite du diamant vert» et du «Diamant du Nil» cède la place à un humour méchant, ravageur, qui sied superbement à Kathleen : «Ce film est très différent des deux autres que j’ai tournés auparavant avec Michael et Danny, avoue-t-elle. Ce dernier n’était plus un simple comparse, mais le patron. Quant à Michael, n’assumant plus les responsabilités de producteur, il a pu se consacrer entièrement à son jeu. Le résultat auquel il est parvenu est mille fois plus intéressant et excitant que tout ce que nous avons pu faire ensemble auparavant». Définissant son personnage, elle ajoute : «Barbara a une forme de liberté que j’envie. Elle n’hésite pas à transgresser les règles du savoir-vivre et de la bienséance. Elle se moque totalement de ce que peuvent penser les autres. La peur du qu’en-dira-t-on ne l’empêche jamais d’agir. Elle sait exactement ce qu’elle veut et ce .qui est juste et injuste. Elle ne doute pas un seul instant. Certes, cela peut aller jusqu’à manque de considération pour autrui, et même jusqu’à un côté terriblement destructeur. Mais l’aspect positif, c’est sa volonté farouche et sa faculté d’agir sans arrière-pensée…» Cette détermination est on ne peut mieux accueillie par le public américain qui catapulte «La guerre des Rose» à la première place du box-office pendant près de trois mois. Une bonne nouvelle de plus pour Kathleen Turner dont les derniers films («Julia et Julia», «Scoop») n’ont pas réalisé les résultats escomptés. Remises en selle, Jessica, Meryl et Kathleen peuvent aujourd’hui dormir tranquilles et aborder sereinement le virage des années 90. Dans les coulisses, de tendres biches et des louves affamées attendent leur tour. Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah et les autres sauront être patientes. Elles connaissent les règles du jeu. Et ce jeu-là vaut tellement la chandelle…
 Quand Woody Allen louche sur Bergman (on pense à «Sonate d’automne») en faisant un détour par Tchekhov… «September» est de la veine des films réalistes et psychologiques comme «Intérieurs» ou le récent «Une autre femme». L’humour est gommé au profit du sérieux, voire même du besogneux. Mais Woody Allen reste un formidable auteur de dialogues. Le cinéaste filme un groupe de six personnages en quête d’amour. Dans une maison de campagne, baignant dans les teintes automnales, Allen regarde leurs désirs avoués ou cachés, leurs doutes, leur dérobades, leurs mélancolies, leurs souvenirs, leurs aveux tardifs. Coincés dans ce huis clos feutré, mère, fille, mari, amant, famille construisent, tout en dentelle, une fresque «moderato» de la passion humaine tout d’un coup rendue «allegretto» par l’éclat et le déchirement. Des comédiens en grande forme… comme d’habitude.
Quand Woody Allen louche sur Bergman (on pense à «Sonate d’automne») en faisant un détour par Tchekhov… «September» est de la veine des films réalistes et psychologiques comme «Intérieurs» ou le récent «Une autre femme». L’humour est gommé au profit du sérieux, voire même du besogneux. Mais Woody Allen reste un formidable auteur de dialogues. Le cinéaste filme un groupe de six personnages en quête d’amour. Dans une maison de campagne, baignant dans les teintes automnales, Allen regarde leurs désirs avoués ou cachés, leurs doutes, leur dérobades, leurs mélancolies, leurs souvenirs, leurs aveux tardifs. Coincés dans ce huis clos feutré, mère, fille, mari, amant, famille construisent, tout en dentelle, une fresque «moderato» de la passion humaine tout d’un coup rendue «allegretto» par l’éclat et le déchirement. Des comédiens en grande forme… comme d’habitude. Quand un divorcé rencontre une autre divorcée.., ils payent les pots cassés. C’est en gros l’histoire de Rachel et de Mark, deux laissés pour compte du bonheur conjugal. Elle est chroniqueuse gastronomique, style femme émancipée, et fan de psychothérapies. Il est journaliste politique, cavaleur, extravagant, un brin macho. Ils font connaissance au cours d’un mariage, se revoient, s’aiment. Plus qu’une union officielle, leur couple est un challenge, une revanche sur leurs échecs. Un premier enfant les plonge dans la routine des biberons-télé-charentaises. Rachel découvre que Mark la trompe depuis plusieurs années… L’idée de départ était claire : choisir un sujet banal et le disséquer. C’est là où Mike Nichols rame un peu. Il n’analyse pas, il brode. Les drames de cœur et les crises désespérées reposent essentiellement sur un tandem hyper professionnel, bourré d’effets de style. La subtilité et l’humour qui animaient «Le lauréat» ou «Ce plaisir qu’on dit charnel» (grands crus Nichols) ne meublent malheureusement pas ici les pointillés d’un scénario qui manque d’armature. Restent deux monstres sacrés qui cabotinent avec leur technique habituelle. Demi-réussi, ou demi-raté, au choix.
Quand un divorcé rencontre une autre divorcée.., ils payent les pots cassés. C’est en gros l’histoire de Rachel et de Mark, deux laissés pour compte du bonheur conjugal. Elle est chroniqueuse gastronomique, style femme émancipée, et fan de psychothérapies. Il est journaliste politique, cavaleur, extravagant, un brin macho. Ils font connaissance au cours d’un mariage, se revoient, s’aiment. Plus qu’une union officielle, leur couple est un challenge, une revanche sur leurs échecs. Un premier enfant les plonge dans la routine des biberons-télé-charentaises. Rachel découvre que Mark la trompe depuis plusieurs années… L’idée de départ était claire : choisir un sujet banal et le disséquer. C’est là où Mike Nichols rame un peu. Il n’analyse pas, il brode. Les drames de cœur et les crises désespérées reposent essentiellement sur un tandem hyper professionnel, bourré d’effets de style. La subtilité et l’humour qui animaient «Le lauréat» ou «Ce plaisir qu’on dit charnel» (grands crus Nichols) ne meublent malheureusement pas ici les pointillés d’un scénario qui manque d’armature. Restent deux monstres sacrés qui cabotinent avec leur technique habituelle. Demi-réussi, ou demi-raté, au choix.

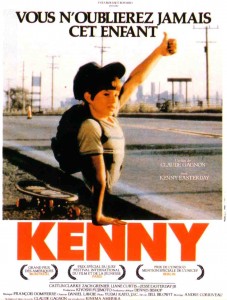
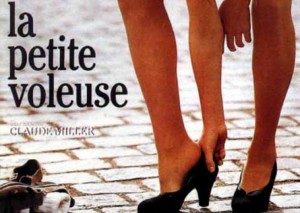


 Chandler Jarrell, dont la vocation est de retrouver des adolescents portés disparus, se trouve confronté à la curieuse demande d’une jeune femme : libérer un enfant tibétain doté de pouvoirs divins, séquestré par un «suppôt de Satan». Mixture concoctée avec un zeste de Superman-Kung-fu, un doigt de Mad Max et des restes de Conan et autre aventurier de l’arche perdue, ce film enchantera certainement les moins de dix ans. Malgré les inévitables effets spéciaux (disparitions, explosions et monstres) et une histoire où même Sinbad le marin demanderait grâce, le résultat est médiocre. Eddie Murphy nous fait rire deux fois, peut-être trois et se demande ce qu’il vient faire dans cette galère. Nous aussi…
Chandler Jarrell, dont la vocation est de retrouver des adolescents portés disparus, se trouve confronté à la curieuse demande d’une jeune femme : libérer un enfant tibétain doté de pouvoirs divins, séquestré par un «suppôt de Satan». Mixture concoctée avec un zeste de Superman-Kung-fu, un doigt de Mad Max et des restes de Conan et autre aventurier de l’arche perdue, ce film enchantera certainement les moins de dix ans. Malgré les inévitables effets spéciaux (disparitions, explosions et monstres) et une histoire où même Sinbad le marin demanderait grâce, le résultat est médiocre. Eddie Murphy nous fait rire deux fois, peut-être trois et se demande ce qu’il vient faire dans cette galère. Nous aussi…




